Je ne connais pas d’autre actualité que celle de mes passions. Me voici pris d’enthousiasme pour un chef d’œuvre vieux d’à peine cent quarante deux ans (et dont j‘ignorais jusqu’à l’existence il y a encore quelques jours) Daniel Deronda, de la romancière anglaise George Eliot, paru en 1876 – à l’apogée du règne de la reine Victoria – et traduit pour la première fois en français en 1881 (traduction nouvelle d’Alain Jumeau, Gallimard, 2010, Folio classique, deux volumes).
Je découvre, ébloui, stupéfait, un extraordinaire roman de la maîtrise (ou de la possession, au sens magique du terme) et de la déprise. Une fantastique intuition de ce qui constituera, vingt ou trente ans plus tard, la matrice du freudisme. Une prémonition de ce que Theodor Herzl allait très bientôt théoriser sous le nom de l’« Etat juif ». Une réhabilitation, assez rare dans l’histoire de la littérature romanesque, du Juif comme héros positif, comme penseur de l’Histoire, comme homme d’action.
Tout commence devant la roulette d’un casino, dans une ville d’eau allemande. Gwendolen, « une enfant gâtée » d’une vingtaine d’années, très belle, très consciente de sa beauté, sait qu’elle est le centre de tous les regards. Mais « pourquoi le désir de la regarder était-il ressenti comme une contrainte et non comme une envie à laquelle tout l’être consent ? ». Elle exerce son magnétisme – le « regard du malin » -, son désir de possession de ceux qui l’admirent.
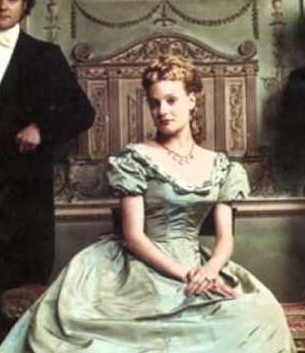
Un homme y est particulièrement sensible : Daniel Deronda, un riche Anglais, « neveu » ou pupille (et peut-être fils naturel) de Sir Hugo Mallinger.
Gwendolen gagne. Elle sent le regard de Deronda, qui la juge et, sans doute, la condamne. Elle se met à perdre. Elle se persuade que « l’œil » du jeune homme a troublé son jeu. « Le sentiment pénétrant qu’il la toisait, qu’il la regardait de haut comme une femme inférieure ». Sur ce jeu de regards, ce combat de domination, va se construire, indéfiniment ramifiée, amplifiée, toute la machinerie du livre.

`Pour rattraper ses pertes et tenter de se « refaire », elle dépose en gage son collier d’émeraudes. Daniel le rachète secrètement et le fait porter à l’hôtel de Gwendolen, avec un mot non signé. Elle sait que c’est lui. Désormais il la « tient » symboliquement par cette dette jamais dite. Mi ravie, mi terrifiée, elle ne s’en libérera jamais.
Elle a l’œil, tout justement, la belle Gwendolen : elle dispute un tournoi de tir à l’arc, dont elle est bien près d’être déclarée victorieuse. Quelle plus parfaite école de maîtrise de soi, que ce sport archaïque dont certains maîtres zen ont fait un instrument de détachement spirituel ! Le drame de Gwendolen, c’est qu’elle hésite entre deux cibles : Deronda et Grandcourt, un aristocrate promis à l’héritage de Sir Hugo, son oncle, qui n’a pas d’héritier mâle.

Las ! Gwendolen apprend, par une lettre de sa mère, que toute la fortune familiale vient de sombrer dans une faillite. Il ne lui reste, comme avenir immédiat, qu’à devenir gouvernante chez un évêque.
Elle rêve de gagner sa vie en exerçant un métier (ce qui, en cette fin du XIXème siècle, relève – pour une femme – de la provocation ou de la naïveté). Parce qu’elle a donné des petits spectacles de « tableaux vivants », ou qu’elle a fredonné quelques airs d’opéra dans les manoirs du voisinage, elle se croit un talent de chanteuse, ou d’actrice.
Kleismer, un pianiste « génial », le premier Juif à apparaître dans le roman (et le seul ashkénaze), un des rares hommes à toujours dire la vérité, quelqu’en soit le prix, la désabuse : elle n’a aucune chance de réussir.
Il lui reste le mariage. « Un état assez ennuyeux, juge-t-elle, dans lequel une femme ne peut agir à sa guise ». Ou encore : « Je me sens peu sûre d’avoir envie d’être sous la responsabilité de quelqu’un ». Bref, elle redoute de perdre sa maîtrise. « Cette sylphide de vingt ans, aux membres délicats, avait l’intention de commander ».
Ici encore tout se joue sur des regards. Au tournoi de tir à l’arc, Grandcourt arrive en retard. « Elle évitait soigneusement de regarder vers tous les endroits où il était susceptible de se trouver. Elle ne devait pas tourner la tête le moins du monde pour révéler que cela pouvait avoir de l’importance pour elle que le fameux M. Mallinger Grandcourt, dont tout le monde parlait, se présentât ou non (…) Elle déclencha un délicieux tonnerre d’applaudissements en plaçant trois flèches de suite au cœur de la cible ».
Gagné ! Grandcourt demande à lui être présenté.

Pendant la brève période où il lui fait la cour, il lui donne l’illusion qu’elle pourra le dominer. « Elle avait dans l’idée qu’après son mariage, elle serait très probablement en mesure de faire de lui exactement ce qu’elle voudrait ». « Elle allait exercer son pouvoir. »
Elle aurait dû se méfier : « La réserve de cet homme, dont elle était contente, agissait comme un charme, dans tous les sens du terme, l’engourdissait peu à peu ». La possession, encore une fois …
A la veille de lui dire oui, elle apprend que, depuis des années, il entretient une maîtresse, Lydia Glasher, qui lui a donné trois enfants naturels. Elle la rencontre. Elle s’apitoie. Elle promet à la femme de ne jamais rien faire qui puisse lui porter tort, à elle ou à son fils et ses filles.
Elle renonce au mariage et s’enfuie en Allemagne.
Elle revient au bout de quelques jours. La peur de la pauvreté et de la déchéance sociale a vaincu tous ses scrupules. Elle épouse Grandcourt.
Chez George Eliott, pas de pleurnicherie sur la morale et les beaux sentiments ! L’argent, l’argent, la vanité sociale, le goût du pouvoir, voilà ce qui domine la plupart de ses personnages.
Tout se compte, tout se pèse au poids de l’or. Même le révérend Gascoyne, l’oncle de Gwendolen, – un homme d’église – calcule le moindre penny de son budget : sa maison paroissiale « pour rien », ses fils « qui coûtent trop », ses diacres qui servent plus ou moins de domestiques, eux aussi « pour rien ». Son fils Rex amoureux de Gwendolen ? Il n’a aucune fortune, elle non plus, « ils ne peuvent se marier ». Et voilà l’histoire réglée, sans qu’il y ait même à en discuter.
Quitte à se moquer « des romans comme il faut où l’âme de l’héroïne, qui s’épanche dans son journal intime, est remplie de puissance vague, d’originalité et de puissance vague, tandis que sa vie évolue exclusivement dans le monde élégant. » Ou encore « des jeunes gens chez qui l’effort productif du questionnement est soutenu par une rente de trois à cinq pour cent sur un capital pour lequel quelqu’un d’autre a bataillé ».
Gwendolen a trahi sa promesse. Elle a pris la place de Lydia. Elle est désormais torturée par le sentiment de sa culpabilité. Grandcourt, qui sait qu’elle sait, se sert de ses remords pour faire d’elle son esclave « Il avait l’intention d’être le maître d’une femme qui aurait aimé le dominer, et qui aurait été capable, peut-être, de dominer un autre homme. »
Un duel de symboles va lui servir à affirmer son pouvoir. Il exige que Lydia lui restitue une parure en diamants qu’il lui avait laissée en dépôt. La femme délaissée ne cède qu’à la condition d’apporter elle-même le trophée de sa propre défaite à celle qui l’a trahie et vaincue.
Ce qu’elle fait, en joignant au bijou une lettre à Gwendolen lui promettant vengeance et malédiction divine.
« La lecture de cette lettre avait marqué le début de la domination de son mari par la terreur. »
Grandcourt enjoint à son épouse de porter la parure. Elle refuse et, en signe de révolte, enroule à son poignet le collier d’émeraude que Deronda avait racheté chez le prêteur à gage.
« Ce que vous pensez n’a aucune importance. Je désire que vous portiez les diamants. »
Elle finit, bien sûr, par céder.
« Il prend plaisir à faire trembler les chiens et les chevaux ; c’est une partie de la satisfaction qu’il tire du fait qu’il est leur maître », se dit-elle en ouvrant le coffret à bijoux avec un frisson. « Ce sera pareil avec moi ; et moi aussi, je tremblerai. Que puis-je faire d’autre ? »
Deronda, qu’elle voudrait prendre comme confident, sauve de la noyade une jeune fille juive, Mira Lepidoth, qui a tenté de se jeter dans la Tamise.
Mira s’est enfuie de chez son père, qui voulait la prostituer. Elle est venue à Londres pour rechercher sa mère, à qui son père l’avait arrachée.

Deronda, qui – lui même – ne sait rien de ses propres origines, décide de l’aider. Il retrouve ainsi la trace d’un frère de Mira, Ezra, qui lui apprend que leur mère est morte.
Le voici sous le coup d’une double séduction : celle de la très fascinante Mira (mais il sait qu’elle n’épousera jamais qu’un Juif) ; celle d’Ezra, qui se fait appeler Mordecaï, en hommage à Mardochée, l’oncle d’Esther qui a préservé d’un massacre le peuple hébreu, sous le règne du roi perse Assuerus.
Mordecaï est un prophète : « Le principe divin de notre race, affirme-t-il avec orgueil, c’est l’action, le choix, la volonté de se souvenir. Les fils de Juda vont choisir que Dieu puisse de nouveau les choisir. Les temps messianiques sont l’époque où Isr aël décidera de planter le drapeau national. »

Très fortement porté par une connaissance aigue de la Kaballe, il ne renonce à l’alya, au départ pour la Palestine ottomane, où vit déjà une forte communauté juive – le yishuv -, que sous la contrainte de la tuberculose.
Il convainc peu à peu Deronda de la justesse de sa cause.
« Vous ne devez pas être seulement un bras pour moi, mais une âme – croyant ce que je crois –convaincu par mes raisons – espérant en mes espoirs – voyant les visions que j’indique – contemplant une gloire là où j’en contemple une ! »
Faut-il lire cette injonction comme une prise de possession particulièrement diabolique ? Ou comme un retournement – une inversion – de la notion même de possession, qui d’une forme d’esclavage spirituel ferait naître une sorte de libération ?
C’est à ce moment, où il s’affranchit peu à peu des contraintes et des modes de pensée de son milieu, que Daniel Deronda reçoit – pour la première fois de sa vie – une lettre de sa mère, Leonora, l’invitant à venir faire sa connaissance dans un palace de Gênes.
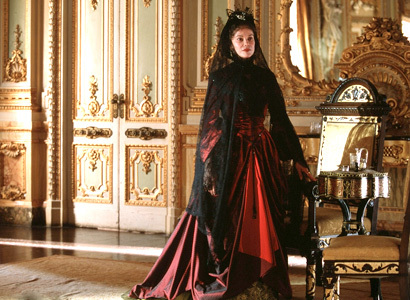
Elle lui révèle son secret : « mon père était juif et vous êtes juif »
En refusant d’assumer sa maternité et en le confiant – dès le berceau – à un aristocrate anglais amoureux d’elle, elle a voulu le « sauver de la servitude d’être juif ».
Hostile à l’idée même de mariage, elle n’avait consenti à épouser un de ses cousins que pour échapper à la volonté de son propre père qui voulait lui imposer sa judéité. « Je pouvais dominer mon mari, mais pas mon père. J’avais le droit de m’affranchir d’une servitude que je détestais. » La domination, toujours …
Le mari est mort. Elle a épousé, en deuxième noce, un prince russe, chrétien orthodoxe. Elle n’a renoncé à sa carrière de cantatrice que lorsqu’elle a perdu sa voix.
Curieux que les trois femmes majeures du roman, Gwendolen, Mira et Leonora tournent toutes autour du désir de chanter : la voix des femmes, voilà peut-être le thème caché.
Curieux aussi que toutes essaient de se construire dans une forme de rupture avec l’autorité parentale (ou ce qu’il en reste) : Gwendolen hait son beau-père et « n’accepte pas que [son] oncle ou une autre personne [lui] dicte sa conduite ». Mira fuit son père, joueur, voleur, proxénète. Leonora refuse le modèle de femme transmis par la tradition juive. Même un personnage relativement secondaire, comme Catherine Arrowpoint (encore une vocation de chanteuse …), s’oppose violemment à ses parents, qui finiront du reste par s’accommoder de leur mariage, en s’enfuyant avec Kleismer, le musicien juif.
Daniel Deronda est donc juif. Il s’appellera désormais Alcharisi, comme son grand père. L’unique obstacle à ses amours avec Mira vient de tomber. Il va l’épouser.
Pauvre Gwendolen ! L’unique et infime espoir qu’il pouvait lui rester de conquérir un jour Deronda vient aussi de s’effondrer. Elle est plus que jamais prisonnière de son mari qui, tout justement, l’enferme, en sa seule compagnie, sur un minuscule voilier au large de Gênes.
Une tempête se lève. Le bateau chavire. Grandcourt meurt noyé, sous les yeux de sa femme, qui se jette à l’eau, mais ne s’empresse peut-être pas vraiment de lui lancer une corde pour le sauver
Elle a tellement rêvé cette mort qu’elle s’en juge coupable. Mais le testament qui ne lui laisse pratiquement rien, au seul profit de Lydia Glasher et de ses enfants, la libère quelque peu de ses angoisses.
L’inconscient joue ici un rôle hautement proclamé : « Il y a en nous de vastes territoires non cartographiés dont il faudrait tenir compte pour expliquer nos bourrasques et nos tempêtes. »
Dès l’enfance, Gwendolen étrangle le canari de sa sœur. Elle refuse de se lever la nuit pour apporter à sa mère le médicament qui la soulagerait. La haine de son beau père lui fait détester le mariage. A peine installée dans sa nouvelle demeure, elle découvre un panneau caché, révélant « l’image d’une tête de mort renversée, que semblait fuir une silhouette obscure, les bras écartés ». Elle exige d’être la seule à détenir la clé du panneau.
« L’idée que la mort de Grandcourt serait la seule délivrance pour elle ne faisait qu’une avec l’idée que la délivrance ne viendrait jamais (…). Des fantasmes s’agitaient en elle comme des fantômes sans pénétrer dans sa conscience claire, mais sans y trouver d’obstruction : en pleine lumière, des rayons obscurs faisaient leur travail invisiblement. »
« Je désirais sa mort. Mais elle me terrifiait, confie-t-elle à Deronda. J‘étais comme deux personnes. Je ne pouvais parler – je voulais tuer – c’était aussi violent que la soif – et puis immédiatement – j‘ai eu l’impression par avance d’avoir fait quelque chose de terrible, d’irréversible – qui ferait de moi comme un esprit du mal. Et c’est arrivé – c’est arrivé. »
George Eliott n’ignore pas non plus le rôle du refoulement. Face à la tentation d’aimer Gwendolen, Deronda sent en lui « un interdit intérieur, servant à contenir des sentiments prêts à s’émouvoir et à faire pencher la balance (…) Il avait toujours été tourmenté par l’idée qu’il fallait se garder de quelque chose non seulement venant d’elle, mais de lui-même ; d’une précipitation dans la manifestation d’un sentiment impulsif. »
La répétition fonctionne enfin comme un des mécanismes-clés de l’entrecroisement des intrigues. En épousant Mira – chanteuse et juive -, Deronda épouse sa mère – juive et chanteuse. En rompant, par son envie de devenir juif, avec l’interdit posé par sa mère, il reproduit, en l’inversant, la rupture de Leonora avec son propre père. En hésitant (c’est le moins que l’on puisse dire) à sauver Grandcourt de la noyade, Gwendolen prend l’exact contre-pied de Deronda sauvant Mira des eaux de la Tamise.
Mordecaï meurt. Daniel Deronda et MIra s’embarquent pour la Palestine.
Peut-être, quelques années plus tard, en 1897, le yishuv les enverra-t-il comme délégués au Congrès de Bâle – le premier congrès sioniste.
George Eliott, elle, a appris l’hébreu et s’est initiée à l’histoire et à la culture juives. Elle meurt en 1880, sans avoir jamais été mariée, peu de temps après le compagnon de toute sa vie, lui-même séparé de son épouse et de ses enfants.
PS Trois versions de Daniel Deronda ont été tournées par le cinéma et la télévision. Je leur emprunte les images qui figurent ici.
