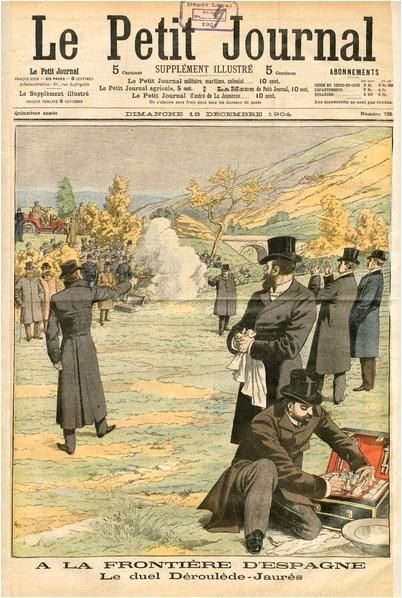“Je suis saoûl de vertu jusqu’à la nausée.”
Non, ce n’est pas de la France d’aujourd’hui qu’il s’agit, mais de l’URSS des années trente.
N’empêche. Une telle phrase, écrite en 1937, me donne d’emblée l’envie de découvrir cet écrivain quelque peu maudit, en qui se dissimule peut-être un frère : Pierre Herbart (1903-1974).

Un frère ? Oui, quelques points communs : une famille “bourgeoise” (les guillemets d’incertitude sont pour moi, non pour lui), – source de maladive mauvaise conscience ; un passage au parti communiste soldé par une rupture brutale.
Et d’évidentes différences : je n’ai jamais eu le goût des “garçons” (mais il en parle avec tant de subtilité, de lucidité, de tendresse, que j’y retrouve toute la saveur lointaine de mes histoires de “filles”) ; je m’incline devant ses engagements poussés jusquà l’ultime : le départ pour l’URSS, la guerre d’Espagne, la Résistance. Je me suis toujours contenté de faire des phrases.
Son grand-père a fondé les Chantiers navals de Dunkerque, préside la Chambre de commerce, siège au Conseil d’administration des Chemins de fer du Nord. Mais est-il vraiment son grand-père ? (Jean-Luc Moreau, “Pierre Herbart, l’orgueil du dépouillement”, Grasset, 2014).
Le “père”, jamais doté d’un prénom, a refusé de prendre sa place dans une dynastie aussi imposante. Il s’est enfui quand le petit Pierre (rebaptisé Guillaume dans les “Souvenirs imaginaires” – Gallimard, 1968) n’avait que cinq ans. Il est devenu clochard. Après quelques années d’errance, la police a retrouvé son cadavre dans un fossé. La figure de ce hors-la-loi hantera toute sa vie l’écrivain Herbart.
C’est son demi-frère, Louis, l’opiomane, qui lui révèlera, au seuil de l’adolescence, le secret de famille : la mère – la très belle Eugénie-Marguerite – avait un amant, le “Viking”, qui, jusqu’à sa mort, s’occupera du fils adultérin. Le “père”, à peine célébrées les noces, n’a sans doute pas supporté l’affront.

De livre en livre, le thème du secret obsède Pierre Herbart. Dans le plus beau de ses romans, “La Licorne” (Gallimard, 1964), le mystérieux “oncle Jules” occupe une chambre au premier étage, d’où il ne sort jamais et où nul n’a le droit de pénétrer, sauf Madame Pons, la vieille gouvernante. “Défunte Madame”, la mère de Juliette, a tout fait pour empêcher son mariage avec Martial, parce que, disait-elle, elle a trop bien connu le père du jeune homme. Est-ce donc un inceste ?
Nul ici n’est à sa place. Chacun, chaque soir, au gré de ses caprices, choisit son lit dans l’immense maison. Ni Madame Pons ni Martial ne savent jamais, chaque matin, où retrouver Denis et Luc, les deux adolescents que viendra bientôt rejoindre Bruno, pour le temps des vacances.
Nul ne sait plus quel lien du sang l’unit aux autres;
“Juliette, ce n’est pas ma soeur, c’est ma cousine, dit Denis.
– Comment ça, ta cousine?
– Puisqu’elle est mariée à mon cousin,
– C’est la femme de mon beau-frère, ajoute Luc.”
Il faut dire que Pierre Herbart, déjà marqué par la malédiction de ses deux “pères”, a peut-être quelque mal à se situer clairement dans ses familles d’adoption.
Débarqué à Paris aux approches de ses vingt ans, il fait très vite la connaissance de Cocteau, à qui il a écrit son admiration et qui devient son premier “parrain” en littérature (et sans doute dans la vie). L’un et l’autre subissent en même temps les souffrances d’une désintoxication à l’opium, ce qui donne lieu à une correspondance où ils échangent leurs confidences.

La scène finale se déroule en juillet 1929 à La Colline, la propriété de Coco Chanel à Roquebrune. Cocteau s’y trouve déjà avec son amant, Jean Desbordes, au bord de la rupture ; contraint de rentrer à Paris pour corriger les épreuves des “Enfants terribles”, il “confie Jean” à Herbart – “ce qui allait nous précipiter dans les pires folies” raconte ce dernier dans ses “Histoires confidentielles” (Grasset, 1970).
“Un matin, je flânais sur la terrasse quand j’entendis un bruit de pas derrière moi. Je reconnus, d’après ses photographies, André Gide, qui croyait trouver là Jean Cocteau.”
Ainsi s’ouvre pour lui sa deuxième famille d’adoption.

Et quelle famille ! Gide, comme chacun sait, a épousé sa cousine Madeleine, qui mourra vierge quarante-trois ans plus tard. Il entretient une longue amitié avec la “Petite dame”, Maria Van Rysselberghe (elle-même attirée par Lesbos), dont la fille, Elisabeth, rêve d’avoir un enfant hors mariage. Gide jette la jeune femme dans le lit de son amant, le cinéaste Marc Allégret, avec qui il partage l’appartement de la rue Vaneau. Échec total.
Un matin de juillet, Gide lui-même se décide, au bord de la mer, à prendre le relais. Réussite immédiate : une fille, Catherine, va naître, que l’écrivain reconnaîtra, après la mort de sa femme.
Le 15 septembre 1931, Pierre Herbart (vingt-huit ans) épouse Elisabeth, qui a treize années de plus que lui. On peut imaginer que Gide a tiré les ficelles de ces noces inattendues. Les deux nouveaux époux ont pourtant échangé, depuis des mois, une correspondance amoureuse, qui ne laisse guère de doutes sur leurs sentiments.
Assez curieusement, dans les six livres d’Herbart que j’ai lus (sur une douzaine), pas une seule ligne ne semble consacrée à Elisabeth, sauf dans “En URSS”, où elle apparaît brièvement sous la forme d’une simple initiale : “E”, et rien de plus.
Je passe, par esprit de charité, sur le troisième “père d’adoption”, Roger Martin du Gard : le souvenir des “Thibault”, dont mes parents ont abreuvé mon adolescence, me laisse encore, soixante-dix ans plus tard, un arrière-goût de soupe amère.
Elisabeth supporte les amants innombrables. Elle ne pardonne pas la liaison passionnée avec une femme, Charlotte Aillaud, – la soeur de Juliette Greco. Elle demande et obtient le divorce en 1968. Pierre Herbart, lui, se satisfait de mettre à distance l’hostilité que lui témoignait Catherine Gide, sa belle-fille.
“Familles, je vous hais !”. ils eussent tous dû relire les “Nourritures terrestres” !
“L’âge d’or” (Gallimard, 1953) semble tout entier voué à l’amour des garçons. S’étonnera-t-on que je m’y délecte d’un portrait de femme ?
Lucienne, “mannequin chez Patou” (ce qui me rappelle quelques souvenirs personnels…), rencontrée un soir au “Boeuf sur le toit”, un bar de la rue Boissy d’Anglas où se retrouvait toute l’avant-garde artistique, littéraire ou mondaine : “Il y avait dans sa beauté quelque chose de meurtri. Le regard calme de ses yeux gris se posait distraitement sur les choses, sur les êtres ; son sourire semblait venir de très loin et n’éclore sur ses lèvres qu’avec le consentement réfléchi de tout son être. Jamais femme ne fut plus dépourvue d’éfféterie. Rêveuse et placide, elle ne prêtait qu’une attention distraite aux remous que suscitait toujours sa présence.”

Elle le loge. Elle l’habille. Elle l’emmène, le dimanche, dans une auberge des bords de Marne. Elle l’aime. Il s’ennuie. “Aujourd’hui encore je ne puis penser à elle sans estime. C’est un sentiment dont je ne suis pas prodigue.”
Les femmes, il va les regarder sans désir au bordel du “Grand cinq”.
“Pour moi, je ne consommai que de la bière.”
A côté de cette tiédeur, quel enthousiasme, quel appétit, quelle folie pour les adolescents de rencontre !
Dans un cabaret de mariniers, “où les garçons dansaient ensemble, se tenant aux épaules, la casquette sur l’oreille, avec cet imperceptible déhanchement qui était à la mode à cette époque et donnait tant de grâce à leurs pas”, Pétrole, dix-sept-ans, l’aborde : “Tu en fais une avec moi?”
Le voici donc embarqué sur la “Marie-Louise” (on se croirait dans une chanson de Damia, ou de Lucienne Boyer…). Une bagarre dans un bal. Ils sont l’un et l’autre blessés. Le goût du sang ravive leurs désirs. “A la fin, de colère,il me mordit cruellement et nous nous mêmes à lutter sur l’étroite couchette.”

“La lèvre retroussée de Pétrole, la ligne si fraîche de sa mâchoire, ses yeux très légèrement obliques, toujours un peu clignés et dont l’iris bleu pervenche était marqué de deux petits points sombres, tout ce visage enfin, je ne pouvais le contempler sans un incompréhensible déchirement, un sentiment de paradis perdu. Etait-ce l’idée qu’il se flétrirait, ou que je le perdrais, que je cesserais de l’aimer ? Est-ce la brusque certitude que la beauté ne se possède pas, qu’aucune étreinte ne peut vous la livrer, qu’il faudrait la saisir autrement qu’en jouissant d’elle mais que les hommes ne disposent d’aucun autre moyen d’entreprendre sa conquête ? (…) L’histoire de mes rapports avec Pétrole est celle du triomphe de mon corps, de la quotidienne déroute de mon amour.”
Il règne dans toutes ces amours comme une incertitude de l’être, une volonté désespérée de “se conserver une sorte de réalité confidentielle”. La mort est toujours là, qui les guette.
Quelque chose en Pierre Herbart évoque sans doute Lawrence d’Arabie : celui des “Sept piliers”, mais aussi et surtout celui de “The Mint” (que l’on a maladroitement traduit en “La Matrice”) : l’indétermination existentielle qui produit l’aventurier en sa tragédie secrète.
Il crache sa vérité dans un livre étonnant, “La ligne de force” (Gallimard-L’imaginiaire, 1958), où il met à nu toute la dérision de ses engagements supposés glorieux.
Il est l’anti-Malraux.
Tout commence, de la même façon, dans ce que l’on appelait alors l’Indochine française. Il a vingt-huit ans, il n’a jamais fait d’études (aurait-il, comme Malraux, raté son bac ?), il a traîné un temps – pour le plaisir – dans les bouges d’Afrique du Nord (et dans l’entourage opiacé de Lyautey). Le voici qui rejoint à Saïgon la journaliste Andrée Viollis, envoyée spéciale du “Petit Parisien” sur les traces du ministre des Colonies Paul Reynaud.

La police ne le laisse même pas débarquer : arrêté pour des propos “séditieux” tenus sur le bateau. Libéré sur ordre du gouverneur, il n’a rien de plus pressé que de se précipiter dans une fumerie d’opium -“une pour Chinois, pas pour coloniaux.” La meilleure clé pour comprendre le pays, explique-t-il à Viollis, c’est de relire “Crime et châtiment”.
Anti-colonialiste forcené depuis son séjour en Afrique du Nord, mais sans illusions sur les luttes anti-coloniales (nous sommes en 1931…) : “En ce combat douteux, ils gagnent, c’est-à-dire qu’ils rejettent leurs maîtres étrangers, se choisissent, dans leurs propres rangs, d’autres maîtres – et changent d’esclavage. Mais ceci ne nous regarde plus. Ils ont atteint leur maturité nationale. Qu’ils se débrouillent !” Et, avec une lucidité assez terrifiante : “Juste de quoi rigoler plus tard en répétant : “Je vous l’avais bien dit !”
Ce qui ne l’empêche pas de dresser un acte d’accusation redoutable : “un cadavre tous les cent mètres sur la route (…) Et s’il n’y avait eu que les morts ! Mais nous devions faire face aux cadavres vivants, les suppliants aux ventres ballonnés qui tendaient vers nous leurs mains en psalmodiant : “Trois grains de riz ! Donnez trois grains de riz!”
Il se fait passer pour “un inspecteur en tournée”, visite et photographie un camp de prisonniers, donne l’ordre de libérer les plus jeunes, engueule les geôliers : “Vous aurez de mes nouvelles par M. l’Administrateur !”
Il a juste le temps de s’enfuir en Chine.
A son retour en France, il prend tout aussitôt sa carte du parti communiste. Il inspire tellement confiance à ses nouveaux camarades qu’ils l’envoient à Moscou – récompense suprême – diriger l’édition française de la revue “Littérature internationale”.
Ici encore, pas d’illusion fanfaronne : “Autant le dire, le “militantisme” (c’est lui qui met les guillemets”) m’ennuyait horriblement.” Dès les premiers jours, il est pour le moins étonné de l’abîme entre la misère des ouvriers et le luxe dans lequel vivent les “élites”. Ah ! Le bal costumé dans la datcha des intellectuels, au sortir du train de banlieue où règnent “un silence exténué, un mutisme de détresse” !

Il se heurte aux censeurs – les glavlit – qui envoient au pilon toute une édition de la revue, parce que la couverture était jaune ! “La couleur de la social-démocratie, camarade ! Impossible !” Il est convoqué au Komintern, dont dépendent tous les communistes étrangers ; il erre dans d’interminables couloirs, contraint de montrer ses papiers à chaque nouvel étage.
Isaac Babel le met au courant de la première grande vague de la terreur stalinienne “Quittez ce pays le plus vite possible ! Et surtout ne laissez derrière vous aucun proche en otage !”
Il ne lui reste qu’à organiser jusqu’au bout la sinistre comédie du voyage de Gide en URSS.
Dès 1937, alors qu’il avait encore sa carte du parti, Herbart avait publié son journal de voyage (“En URSS”, Gallimard), dont il me plaît de ne retenir que la métaphore du pou : “Chaque être ici a ses parasites qui sont ses bureaucrates et c’est par ses bureaucrates qu’on l’atteint. Comme si l’on s’adressait au pou pour savoir comment va le pouilleux. Il va mal, le pauvre, mais le pou est content.”
La guerre d’Espagne détruit ses ultimes illusions : “Nous nous figurions que l’URSS aidait les républicains (…) A Barcelone, des amis anarchistes m’exposèrent leur situation. Traqués par la Guépéou, leurs camarades disparaissaient les uns après les autres. On retrouvait leurs cadavres au bord des routes, une balle dans la nuque…”

“Vous vous êtes mis dans de beaux draps”, lui dit Malraux.
– Pourquoi ?
– Etes-vous absolument sûr que Gide ne va pas publier cela pendant que vous êtes ici ?”
“Cela” c’est “Retour de l’URSS”, le livre-réquisitoire de Gide (Gallimard 1936), dont Herbart vient de faire lire les épreuves à Malraux.
Gide, malgré ses promesses, le publie sans tarder.
Branle-bas de catastrophe à l’ambassade soviétique de Madrid, où Herbart a l’étrange idée de se réfugier.
Seule l’intervention d’André et de Clara Malraux lui permet miraculeusement d’échapper à ce piège.
Ce Malraux pour qui, écrivait Herbart, “le sens de la grandeur, c’est peut-être de mourir pour une cause qui lui sert avant tout de prétexte à satisfaire son goût profond du tragique.”
Herbart, lui, se fiche de la grandeur. Il la méprise. Il la fuit. La tragédie, il la porte en lui : fils adultérin, faux rejeton d’un vagabond dont il porte le nom et qu’il élit pour père. C’est elle qui lui permet toujours de se mettre d’emblée à la hauteur de l’Histoire. Mais en porte-à-faux. En acteur-témoin dénonçant inlassablement la médiocrité de la pièce.
Il rentre à Paris. Il déchire sa carte du parti communiste.
La Résistance lui fournit l’ultime épisode de ces combats de dupes, dont il ne cesse de remâcher l’amère saveur depuis qu’il en a découvert les délices en Indochine.
Il n’y croit pas une seule seconde. “Des appels me parviennent, qui ne me concernent pas, puisqu’ils parlent de patrie, d’honneur national, et que les idées, fussent-elles nobles et justes, ne m’atteignent plus, désincarnées.”

Rien qu’un enchaînement logique où les convictions, les sentiments n’ont aucune part : “Les garçons des Chantiers de jeunesse furent conviés à partir pour l’Allemagne. Il n’y avait plus qu’à les faire déserter.”
“Un temps dérisoire et maudit (…) : “On attend, dans la brume d’une station de métro, quelqu’un qu’on ne connaît pas auquel on transmet un message qu’on ne comprend pas concernant des choses que l’on n’approuverait pas si elles vous étaient révélées, mais la quasi-certitude que le “message” ne sera suivi d’aucun commencement d’exécution dédouane votre conscience. En somme, on est – j’étais dans une gratuite enfin passible de la peine de mort.”
Lafcadio, nous voilà ! Retour par “Les Caves du Vatican”. L’ombre de Gide, le “parrain”, rôde encore dans les parages.
Le plus inattendu, c’est que la Résistance prend Lafcadio tout à fait au sérieux : Inspecteur général du Mouvement de libération nationale (MLN) pour la région Nord, puis Délégué général régional pour la Bretagne. Son nom de guerre : Le Vigan. Au point que certains l’affublent même d’un képi étoilé : “général Le Vigan”.
D’autant plus réjouissant que c’est aussi le nom d’un comédien fâcheusement collaborateur, qui accompagne Céline, Lucette et le chat Bébert dans leurs aventures de Siegmaringen…
Herbart libère Rennes, dont il capture et emprisonne le préfet de Vichy. Il y accueille De Gaulle qui, à l’issue de leur unique rencontre, lui enseigne… comment couper les cigares. “Encore un ou deux cigares et ils m’enverront promener le chien.”
“Résistance ? Connais pas “ lui dit le gouverneur de la place, fraîchement nommé. Et Herbart lui-même, évoquant son action clandestine avec des amis : “Des histoires de boy-scouts”.
Toutes les portes devraient s’ouvrir devant lui : député ? Ministre ? Commissaire de la République dans quelque province ? Aucune décoration, aucune prébende.
Il a fondé, dans la clandestinité, le journal “Défense de la France”, qui va devenir “France Soir”. Il s’en fait prestement subtiliser la direction. Il crée un hebdomadaire, “Terrre des hommes”, promis à une très brève existence. Il publie quelques éditoriaux dans “Combat”. Sa lucidité le tue. Chaque journaliste, écrit-il, devrait se poser la même question : “quelle sera la forme de mon mensonge ?”
T.E. Lawrence, disais-je. Oui, le colonel de légende, frustré de toutes ses vaines promesses à ses compagnons d’aventure, et qui s’engage en 1922 dans la Royal Air Force comme soldat de deuxième classe, sous le nom de John Hume Ross. Homosexuel, comme Herbart. Fasciné, comme lui, par les vertiges de la moto. Sauf qu’il connaîtra, lui, la grâce d’un accident mortel.
Alors que Pierre Herbart mourra, à demi paralytique, à l’hôpital de Grasse et sera provisoirement inhumé dans la fosse commune, avant que ses amis ne fassent transférer sa dépouille dans une sépulture plus digne.
Clochard, ou peu s’en faut, comme son « père ».
“Je me suis trouvé, comme par hasard, et en grande compagnie, sur les lieux du crime, non tant pour le dénoncer, mais pour l’assumer peut-être, alors que j’étais innocent”, confesse Herbart en 1958, alors qu’il est déjà retiré de tout.
Qu’a-t- il raté ? A-t-il, à un moment, commis une faute ? Oui, répond-il, je me suis “écarté de ma ligne de force (…), celle qui donne un sens à la vie (…) pour m’occuper de riens : la colonisation, le colonialisme, la guerre d’Espagne, la Résistance. Que sais-je ? (…) Je ne saurais trop conseiller aux autres de perdre moins de temps que moi.”
Sa “ligne de force” ? Aimer, créer, saisir au vol tous les instants de grâce qu’offre une vie.
Il s’est inventé un style.
Style de vie vagabonde, aventureuse, passionnée, sensuelle, traversée d’éclairs, imprégnée d’art et de littérature.
Style d’écriture : il se situe dans la lignée des grands portraitistes à la française ; ses portraits de femmes (Lucienne, Daphné, N la Russe – jamais dotée d’un prénom, pour ne pas la compromettre …) , ou d’adolescents dévorés de caresses (Alain, Pétrole, Auguste, Marius, tant d’autres …) font revivre ses amours avec une vivacité, une rapidité d exécution délectables.
Il sait (privilège rare) animer sans enflure une scène de tragédie, voire d’apocalypse : la mort d’Alain à l’hôpital, enchaîné sur son lit, baillonné, et qui tente en vain de hurler le nom de Pierre ; la famine en Indochine et le bagne des prisonniers politiques ; la déambulation sous les bombes dans les décombres de Madrid assiégée, avec tous les parfums de la vraie vie qui remontent et qui permettent d’identifier chacune desz boutiques détruites …Ou la dernière nuit avec N, dans une chambre d’hôtel à Moscou, où il bâfre, se saoûle à mort pour ne pas crier, mais « même si cela ne doit durer qu’une heure, que cinq minutes, qu’une minute, « c’est le bonheur », me disais-je. »
Son art suprême, c’est l’ellipse. L’essentiel, la racine des êtres et des choses, il nous les laisse un peu deviner, il nous en aguiche le désir, il ne nous les dit jamais. « « A quelques mois de là, écrit-il par exemple, je rencontrai un être avec lequel je devais passer les années les plus tourmentées de mon exitence. Je ne dirai rien de cette période. Cinq ans passèrent jusqu’au coup de pistolet qui me délivra à la fois de ma plus grande joie et de mon enfer. ». Ou encore : « De la Chine je ne dirai pas un mot. Je garde cette poire pour la soif. »
Ne jamais trop dire pour garder le juste dire.